Dans un monde de plus en plus standardisé, nous affirmons notre identité en défendant notre individualité. Devant les forces impersonnelles et déshumanisantes qui nous menacent d’anonymat, nous réagissons en disant : je ne suis pas un numéro, mais je suis une personne ! Or ce sursaut d’humanité nous met sur le chemin de la personne.
En effet, dire que je suis une personne, et non pas seulement que je suis un homme, focalise l’attention sur l’individualité qui est la mienne. À l’inverse, s’en tenir au fait que je sois un homme pourrait avoir pour effet de gommer ce que mon existence a d’unique : le risque serait alors de ne voir, dans l’homme que je suis, qu’un exemplaire d’une espèce, l’espèce humaine. Et si je ne suis qu’un représentant d’une espèce, à côté de milliards d’autres, qu’est-ce qui fait de moi un être irremplaçable ?

Toute personne est un individu, mais l’inverse n’est pas vrai, car tout individu n’est pas une personne ! Certes, il est indéniable que l’homme existe toujours de manière individuelle : on ne rencontre jamais l’humanité, car ce sont toujours des hommes individuels que l’on rencontre. Mais on ne peut pour autant réduire l’homme à l’individu, car, alors, je ne dis rien qui le distingue comme homme, s’il est vrai qu’un frigidaire aussi est un individu ! Raison pour laquelle le concept de personne est nécessaire : il permet de désigner l’homme comme un individu qui n’est pas de n’importe quelle espèce, mais qui est d’une espèce déterminée.
Or qu’est-ce qui fait la spécificité et la dignité de l’homme ? C’est la pensée, impliquant les capacités de parler, de chercher et de trouver un sens, de se rapporter au bien et au mal, etc., même si ces capacités peuvent parfois être en devenir (la vie à ses débuts) ou diminuées (la fin de vie). De ce point de vue, un animal ne pense pas (un animal ne se pose manifestement pas la question de l’origine de l’univers), pas plus qu’une machine (on n’a jamais vu une machine chercher le sens de ce qu’elle fait). L’homme n’est donc pas seulement un individu, mais c’est une personne, car c’est un individu d’une nature déterminée, un individu qui possède la rationalité. La première définition de la personne qui est apparue dans l’histoire est du reste celle-ci : la personne est un individu de nature rationnelle, et c’est pour cela qu’être une personne est une dignité. Par conséquent, personne et individu ne sont pas interchangeables.

Mais il existe une troisième dimension de la nature humaine, en plus de la rationalité et de la liberté, que la personne exprime tout spécialement : la relation aux autres. Si je me contente de voir dans l’homme un homme, j’envisage sa relation à autrui de manière très abstraite : j’affirme simplement qu’il a en commun avec n’importe quel autre homme d’être, comme lui, un homme. Quand je conçois l’homme comme un individu, je le conçois tout simplement abstraction faite de ses relations à autrui : c’est une unité fermée sur elle-même, une monade, alors que, dans la réalité, l’homme existe et vit en relation avec d’autres hommes. Mais quand je conçois l’homme comme une personne, j’inclus, dans le regard que je porte sur lui, le tissu de relations concrètes dans lequel chacun se trouve inséré. Cette composante de la relation est pour ainsi dire dans l’ADN historique du terme même de personne : la personne, dans le théâtre antique, était le rôle bien identifié joué par un acteur, le masque qu’il porte et qui le fait reconnaître comme jouant un personnage précis.
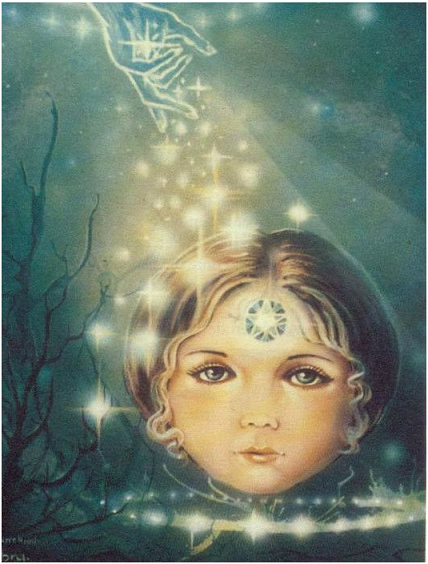
Or la personne comme acteur de théâtre n’est pas seule sur scène : la pièce de théâtre dont vient notre terme même de « personne » n’est pas un one-man-show, mais c’est une pièce qui comprend plusieurs acteurs, plusieurs rôles, qui forment une intrigue ayant cohérence et unité. Autant dire qu’il appartient à l’être même de la personne de ne pas être seule sur scène, mais d’agir de manière coordonnée avec d’autres personnes. La personne émerge donc sur fond de relations interpersonnelles.
Cela se voit aussi dans l’emploi grammatical du terme, lui aussi très ancien : la personne, qu’il s’agisse de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème, se définit toujours en relation avec les autres, avec plusieurs personnes. L’origine dramaturgique et l’origine grammaticale de la notion de personne indiquent qu’il est essentiel d’envisager l’homme dans sa relation aux autres : l’homme prend à juste titre le nom de « personne », car il est constitutif de la personne de viser une forme d’union ou de communion avec d’autres personnes.
EXTRAIT SOURCE : Cahiers Pro Persona – 3 https://www.propersona.fr/wp-content/uploads/2017/09/ProPersona_ANTHROPO_04_WEB_V2.pdf
